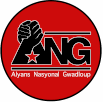Historique
📚 Historique complet de l’eau en Guadeloupe
De la départementalisation de 1946 à la crise actuelle : 75 ans d’histoire retracent l’évolution de la gouvernance de l’eau en Guadeloupe et les causes structurelles de la situation catastrophique d’aujourd’hui.
Deux perspectives complémentaires pour comprendre comment nous en sommes arrivés là
Historique institutionnel
De la tutelle de l’État après la départementalisation à la création du SMGEAG en 2021, retour sur l’évolution de la gouvernance de l’eau en Guadeloupe.
🏛️ Période de tutelle de l’État
Après la départementalisation de 1946, la DDE (Direction Départementale de l’Équipement) — bras technique de l’État pour les infrastructures — assurait la production et la distribution d’eau potable dans de nombreuses communes, notamment rurales.
- Missions de la DDE : Planification et construction des réseaux, maîtrise d’ouvrage des infrastructures (barrages, captages, stations de traitement)
- Exploitation directe du service dans les zones non couvertes par les communes
- Compétence générale de l’État en matière d’aménagement du territoire et d’hygiène publique
- Construction du réseau initial dans les années 1960-1970
🏗️ Développement infrastructurel
Avec les grandes politiques d’aménagement des DOM-TOM, l’action pour l’accès à l’eau potable a été largement portée par l’État et les structures d’équipement (ex. SODEG).
Création des premiers opérateurs locaux :
- 26 avril 1963 : Création du « Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Pointe-à-Pitre » (futur SIAEAG)
- 1969 : Signature du contrat d’affermage avec la Générale des Eaux Guadeloupe
- Création du Syndicat Intercommunal du Sud de la Côte Sous le Vent (SISCSV)
- Création du Syndicat Intercommunal des Grands Fonds (SIGF)
- Création du Syndicat Mixte du Nord Grande-Terre (SMNGT)
🏙️ Urbanisation et décentralisation majeure
Avec l’urbanisation et l’augmentation des besoins (agriculture, tourisme, habitat), la question de la ressource et de la qualité devient plus pressante. Les années 1980 marquent une prise de conscience croissante du « problème de l’eau » : quantité, qualité, pertes réseau.
Transferts progressifs de compétences :
- La DDE cesse d’être exploitant direct
- Les syndicats intercommunaux reprennent progressivement les réseaux de la DDE
- Transferts matériels et financiers actés par arrêtés préfectoraux entre 1984 et 1995
- Premières coupures d’eau sporadiques dans certaines communes
- Début de la dégradation des canalisations en amiante-ciment
📋 Cadre réglementaire moderne
Mise en place d’outils de planification (SDAGE, schémas départementaux) et montée en puissance d’acteurs techniques et financiers locaux : Office de l’eau Guadeloupe, comité de bassin, Observatoire de l’eau.
Fin de l’intervention directe de la DDE :
- Vers 1998-1999, la DDE de la Guadeloupe cesse toute activité directe d’exploitation de réseaux
- Les derniers réseaux ruraux sont transférés aux syndicats locaux
- Les personnels techniques sont redéployés ou mis à disposition des nouvelles régies
- Lois nationales et directives européennes confirment la pleine compétence des collectivités
- Taux de pertes estimé dépassant déjà les 40-50%
📉 Fragmentation et sous-investissement
La Guadeloupe est gérée par un ensemble fragmenté d’acteurs : communes, plusieurs syndicats intercommunaux, régies, opérateurs privés. Cette fragmentation a contribué à un sous-investissement chronique sur certains réseaux.
- Taux de pertes élevés et performance inégale selon les territoires
- Difficultés de coordination entre les différents acteurs
- 2007 : Fin du contrat d’affermage avec la Générale des Eaux Guadeloupe (en vigueur depuis 1968)
- Après 2000, la DDE (puis DEAL) n’intervient plus que pour l’appui technique et la programmation d’aides de l’État
- Tours d’eau devenant la norme dans de nombreuses communes
🔍 Crise révélée et nécessité de réforme
Les enquêtes, audits et rapports mettent en évidence des difficultés financières et de gouvernance chez certains syndicats (ex. SIAEAG) et la nécessité d’une réforme pour centraliser et fiabiliser la gestion.
- Taux de fuite alarmant atteignant 60-70%
- Manque d’entretien des réseaux vieillissants
- Discontinuité chronique du service
- 2015 : La loi NOTRe impose la compétence eau-assainissement aux intercommunalités
- Rapports officiels recommandant une fusion des syndicats
🏛️ Création du SMGEAG
La loi du 29 avril 2021 aboutit, au 1er septembre 2021, à la création du Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG).
- Regroupement et professionnalisation de la gestion sur l’ensemble de la Guadeloupe (hors Marie-Galante)
- Compétences : AEP, assainissement collectif et non collectif, eaux pluviales urbaines
- Objectif : Réduire la fragmentation historique et faciliter les investissements structurants
- Fusion des derniers syndicats indépendants
- Une réforme majeure après 70 ans d’histoire mouvementée
Historique de la crise technique
L’évolution des indicateurs techniques révèle 45 ans de dégradation continue : pertes, renouvellement, rendement du réseau. Les chiffres ne mentent pas.
🌱 Les premiers signes de dégradation
Le réseau d’eau potable installé dans les années 1960-1970 commence à montrer des signes de vieillissement. Les premières fuites importantes sont constatées, mais les autorités publiques minimisent l’ampleur du problème.
- Infrastructure datant de 15-20 ans déjà vieillissante
- Premières coupures d’eau sporadiques dans certaines communes
- Investissements de maintenance jugés « non prioritaires »
- Absence de vision à long terme pour la gestion de l’eau
- Début de la dégradation des canalisations en amiante-ciment
📉 Aggravation progressive
Les coupures d’eau deviennent plus fréquentes, particulièrement en saison sèche. Le taux de pertes du réseau augmente régulièrement sans qu’aucune action corrective majeure ne soit entreprise.
- Taux de pertes estimé dépassant les 40-50%
- Multiplication des ruptures de canalisations vétustes
- Premières mobilisations citoyennes face à l’inaction
- Retards d’investissement cumulés année après année
- Gestion fragmentée entre plusieurs syndicats intercommunaux
🚨 Installation de la crise permanente
Les tours d’eau (rationnement programmé) deviennent la norme dans de nombreuses communes. La population guadeloupéenne doit désormais s’adapter à une distribution aléatoire de l’eau potable.
Le stockage domestique de l’eau devient obligatoire, mais se fait souvent dans des conditions insalubres (citernes non couvertes, contenants inadaptés), créant des risques sanitaires supplémentaires.
- Rendement du réseau tombant sous les 50%
- Tours d’eau généralisés : distribution 2-3 jours par semaine
- Impact économique majeur sur l’hôtellerie et le tourisme
- Problèmes de santé publique liés au stockage inadapté
- Perte de confiance totale dans la gestion publique de l’eau
- Pollution de certaines sources par le chlordécone
💭 Prise de conscience… sans action
Plusieurs rapports officiels dénoncent l’état catastrophique du réseau d’eau guadeloupéen. Les élus reconnaissent publiquement le problème, mais les investissements restent largement insuffisants.
- Rapports alarmants des services de l’État sur le réseau
- Premières estimations du coût de remise en état : plusieurs centaines de millions d’euros
- Manifestations citoyennes contre les coupures répétées
- Complexité de la gouvernance : multiples syndicats intercommunaux
- Absence de schéma directeur cohérent à l’échelle de l’archipel
🏛️ Début de restructuration
La Région et le Département commencent à intervenir financièrement avec des plans de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Premiers efforts coordonnés.
- Début du cofinancement Région/Département sur les équipements
- Mise en place d’un premier plan d’investissement pluriannuel
- Objectif annoncé : améliorer progressivement le rendement du réseau
🔨 Période d’investissement relatif
Entre 2018 et 2021, le SMGEAG réalise ses meilleurs efforts de renouvellement, avec un pic de 27,2 km renouvelés en 2021. C’est la période la plus active depuis la création du syndicat.
- 2018 : 24,25 km de réseau renouvelés
- 2019 : 19,06 km renouvelés
- 2020 : 11,63 km renouvelés
- 2021 : 27,20 km renouvelés (record)
- Mise en place progressive d’un SIG (Système d’Information Géographique)
- Total période : 82,14 km renouvelés sur 4 ans
Malgré ces efforts encourageants, le rythme reste très insuffisant par rapport aux 2 730,9 km de réseau total à entretenir.
✅ Efforts de renouvellement ⚠️ Toujours insuffisant🔄 Réévaluation du patrimoine
Un audit complet du réseau révèle des erreurs d’inventaire importantes : le linéaire total passe de 2 994 km (2020) à 2 593 km (2021), soit une correction de -401 km.
- Réévaluation précise du patrimoine grâce au SIG
- Cartographie numérique progressive du réseau
- Identification des zones prioritaires d’intervention
- 27,2 km renouvelés : meilleure performance annuelle
📉 L’effondrement : année catastrophique
2022 marque un tournant dramatique : le renouvellement du réseau s’effondre à seulement 2 km, soit une chute de 92,6% par rapport à l’année précédente.
Simultanément, la situation se dégrade sur tous les indicateurs :
- 2 km renouvelés : plus bas niveau depuis 5 ans (vs 27,2 km en 2021)
- Pertes en hausse de +12% : indice passant de 46,7 à 52,3 m³/j/km
- Rendement du réseau chutant à 29,1% (71% de pertes !)
- 52,1 millions m³ d’eau perdus sur l’année
- Linéaire total réévalué à 2 730,9 km (+137,9 km découverts)
- Taux de renouvellement : 0,54% seulement
💰 Plan d’investissement ambitieux
Face à l’urgence, un Programme Pluriannuel d’Investissement de 320 millions d’euros est annoncé pour la période 2024-2027, financé par :
- 20 M€ en fonds propres de la Région Guadeloupe
- Cofinancement du Département de Guadeloupe
- Subventions de l’État
- Fonds européens (FEDER)
- Emprunt du SMGEAG
En 2024, opération massive de renouvellement des compteurs : 18 000 compteurs remplacés (sur ~80 000 à changer).
✅ Investissement massif ⚠️ Reste insuffisant face à l’ampleur📋 Rapport accablant de la CRC
La Chambre Régionale des Comptes publie un rapport détaillé et sans concession sur la gestion du SMGEAG, révélant publiquement l’ampleur réelle de la crise.
– Chambre Régionale des Comptes, juillet 2025
Chiffres clés du rapport CRC :
- 208 ans nécessaires pour renouveler tout le réseau
- 36% de taux d’impayés, record national absolu
- 37 M€ de déficit cumulé entre 2021 et 2024
- 60% du réseau a plus de 30 ans d’âge
- 9 000 réparations de fuites effectuées en 2024
- ~80 000 compteurs à remplacer (plus de 15 ans)
📊 75 ans d’histoire, une crise persistante
De la tutelle de l’État à la fragmentation des années 2000, l’histoire de la gestion de l’eau en Guadeloupe révèle les difficultés structurelles qui ont conduit à la crise actuelle. Le SMGEAG représente une opportunité de rupture avec un modèle qui a montré ses limites, mais les défis restent immenses face à des décennies de sous-investissement et de négligence.
📚 Sources officielles
- RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) SMGEAG 2022
- Rapport de la Chambre Régionale des Comptes, juillet 2025
- Observatoire de l’Eau de la Guadeloupe
- France Info – « Il faudrait plus de 200 ans au SMGEAG pour remettre le réseau en état »
- Archives historiques des syndicats intercommunaux (SIAEAG, SISCSV, SIGF, SMNGT)
- Loi du 7 janvier 1983 (loi Defferre) – Décentralisation
- Loi du 29 avril 2021 – Création du SMGEAG